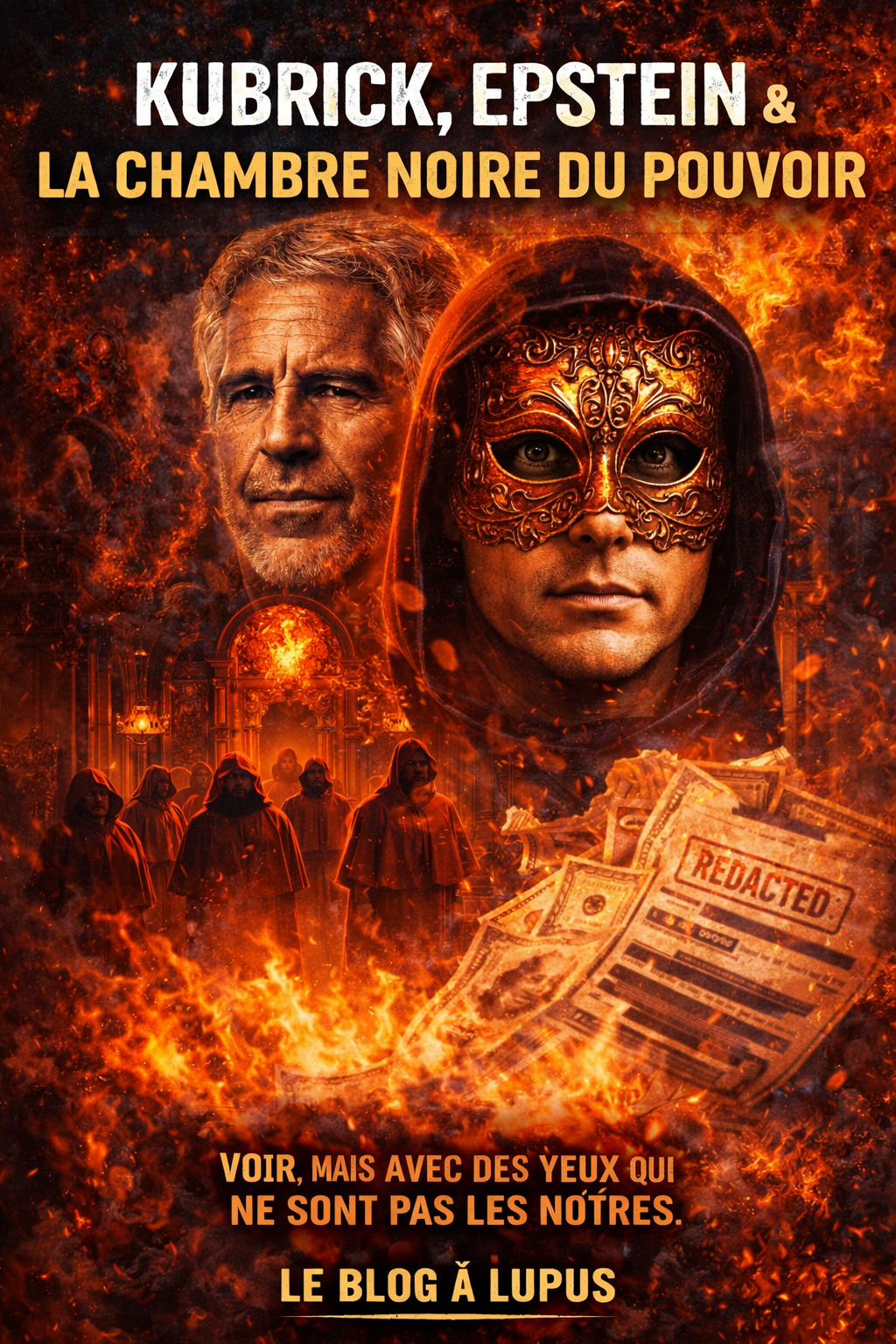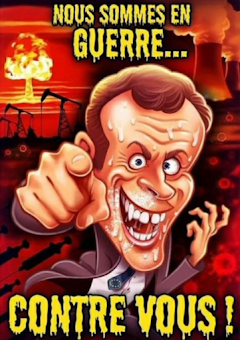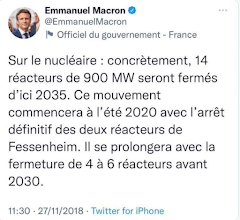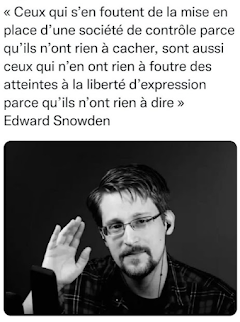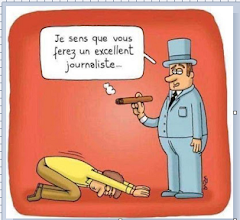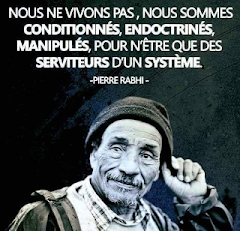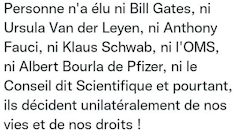On peut noter dès le début du texte qu'il est question de dualité matière / conscience. Ce qui met à mal la néo non dualité commerciale qui tente de nous réconcilier avec la vie quotidienne et ses attachements. La vraie spiritualité consiste selon moi à comprendre que nous sommes spirituels. Nos problèmes au niveau de l'espèce proviennent du fait qu'une telle évidence n'est pas partagée. Il y a une impasse inévitable en s'acharnant à investir un quelconque espoir dans le monde des apprences. C'est même une forme de folie car nous savons tous qu'il ne restera rien, pas un mur et pas un corps... de la folie ! Du déni absurde.
Duc
Notes de traduction
Ashtavakra, ou
Ashtaavakra en
Sanskrit:अष्टवक्र , est un sage (rishi) connu pour le dialogue qu'il a dans l'Ashtavakra Gita avec le prince Janaka. Les informations sur sa biographie viennent essentiellement du
Ramayana. Son nom signifie "huit difformités". L'
Ashtavakra Gita (Sanskrit en Devanagari: अष्टावक्रगीता;
IAST: aṣṭāvakragītā) est un chant qui contient un enseignement philosophique
[1] appartenant avec l'
Avadhuta Gita aux principaux textes de la philosophie non-dualiste
advaita vedanta. Comme tous les textes hindous, ils ont eu une longue existence de tradition orale avant d'être écrit. L'ashtavakra Gita telle qu'elle nous est parvenue date probablement du VIIIème siècle, époque d'essort pour les écoles non-dualistes en Inde.
Les sources utilisées sont toutes issues du web
[2][3]
Un certain nombre de choix ont été faits:
- traduction de samsāra (संसार) par cycle des réincarnation mais cela pourrait aussi être "tout ce qui circule"
- traduction de Vairāgya (Devanagari: वैराग्य)/ dispassion par sérénité
- traduction de Ekaggatā (Sanskrit Ekāgratā, एकाग्रता) par concentration et non par unification (discutable)
Janaka:
Comment la connaissance peut-elle être acquise? Comment la libération peut-elle être atteinte? Et comment atteindre un état sans passion ? Dis-moi. 1.1
Ashtavakra:
Si tu cherches la libération, mon fils, évite les objets des sens comme un poison. Pratique la tolérance, la sincérité, la compassion, la retenue et la vérité comme un nectar. 1.2
Tu n'es pas composé des éléments - la terre, l'eau, le feu, l'air, ou même l'éther. Pour être libéré, connais toi toi-même comme étant la conscience, le témoin de ceux-ci. 1.3
Si tu parviens juste à rester au repos dans la conscience, te percevant toi-même comme distinct de ton corps, alors tu deviendras heureux, paisible et libre de tout lien. 1.4
Suite du texte ==>
ICI <==